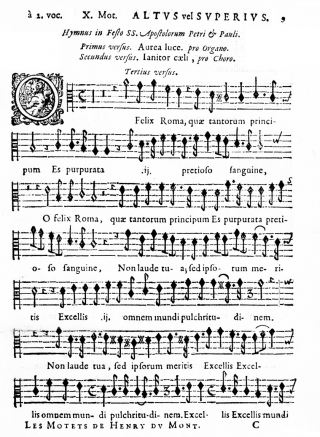Comme chaque 21 janvier depuis 1993, ce n’était pas une mais deux messes solennelles de Requiem pour Sa Majesté le Roi Louis XVI qui étaient célébrées cette année à Saint-Eugène, en ce 228ème anniversaire de la mort.
La messe de 19h fut enregistrée et vous pouvez retrouver celle-ci sur YouTube sur la chaîne Ite Missa Est) :
Voici quelques photos qui rendent compte de la beauté de ces deux cérémonies, avec des extraits du Testament du roi :

Au nom de la très Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Aujourd’hui vingt-cinquième jour de décembre, mil sept cent quatre-vingt-douze, moi Louis XVIème du nom Roi de France, étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le onze du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès, dont il est impossible de prévoir l’issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n’ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m’adresser ; je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments.

Je laisse mon âme à Dieu mon créateur, je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d’après ses mérites, mais par ceux de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier.

Je meurs dans l’union de notre sainte Mère l’Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint Pierre auquel Jésus-Christ les avait confiés ; je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu et de l’Église, les Sacrements et les Mystères tels que l’Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés ; je n’ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d’expliquer les dogmes qui déchirent l’Église de Jésus-Christ, mais je m’en suis rapporté et rapporterai toujours si Dieu m’accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l’Église suivie depuis Jésus-Christ ; je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l’erreur, mais je ne prétends les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ suivant ce que la charité chrétienne nous l’enseigne.

Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés ; j’ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m’humilier en sa présence ; ne pouvant me servir du ministère d’un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j’ai d’avoir mis mon nom (quoique cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l’Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur ; je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis s’il m’accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d’un prêtre catholique, pour m’accuser de tous mes péchés, et recevoir le Sacrement de Pénitence.

Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance (car je ne me rappelle pas d’avoir fait sciemment aucune offense à personne), ou ceux à qui j’aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales de me pardonner le mal qu’ils croient que je peux leur avoir fait.

Je prie tous ceux qui ont de la charité d’unir leurs prières aux miennes, pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés.
Je pardonne de tout mon cœur, à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu m’ont fait beaucoup de mal.
Je recommande à Dieu, ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être ; je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s’ils viennent à me perdre, et tant qu’ils resteront dans ce monde périssable.

Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu’elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher.
Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu’ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les soins et les peines qu’elle se donne pour eux, et en mémoire de moi ; je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère.
Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi.